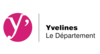Reportage
Fatou, Nassera et Naïla se sont réunies dans la cuisine du centre Luxereau à Trappes, pour préparer des repas qu'elles ont servis à des habitants du foyer Adoma du quartier Jean Macé. Reportage.
De nombreuses associations et autoentrepreneurs, souvent des entrepreneuses, ont participé au marché de Trappes pour financer et développer leurs projets tout en gagnant en visibilité. Reportage.
Pendant une après-midi en fin mai, un groupe de 5 adolescentes du quartier Jean Macé, à Trappes, se sont livrées sur les relations difficiles qu’elles ont avec les garçons de leur âge.
Interview
Dieynaba* habite à Trappes au square Louis Pergaud depuis toujours.
Donovan*, 22 ans, originaire du quartier Thorez à Trappes, revient sur les nuits d’émeutes qu’ont connu de nombreux quartiers populaires déclenchées par le drame du jeune Nahel.
Layna (le prénom a été modifié), 23 ans, habite à La verrière dans le quartier d’Orly Parc, depuis son plus jeune âge. Elle explique son rapport aux garçons et à la pression sociale qu’elle ressent dans son quartier.
Portrait
Sandra est une ancienne maman ayant élevé seule un enfant. Elle explique comment elle s’en est sorti, et comment elle aide d’autres mamans solos à s’en sortir, grâce au numérique.
Après une première carrière en animation, Lhocine Houli découvre le métier de conseiller en insertion à la MIRE de la Verrière, dans lequel il guide au mieux depuis 7 ans les jeunes de 16 à 25 ans de la ville dans leur insertion professionnelle et vers le monde adulte.
Après un parcours pour le moins original, Emmanuel Letourneux, et ses Pop School d’Elancourt et de Gonesse, propose des formations au numérique aux personnes en recherche d’une insertion ou réinsertion professionnelle. Portrait.
Trappy blog radio
Diouka et Maï sont deux jeunes femmes, joueuses, entraineuses, et supportrices de football. Dans cette émission, elles nous racontent leur histoire avec ce sport, de leurs plus jeunes années de joueuse dans leur quartier, à leur rôle d'éducatrice aujourd'hui.
Razane et Assetou sont deux adolescentes qui fréquentent l'espace jeune Paul Langevin, à Trappes. Dans le cadre d'ateliers médias, elles ont décidé que leur...
Imen et Nisrin sont deux soeurs ayant, plus ou moins, grandi au quartier Jean Macé de Trappes. Elles nous racontent comment leurs parcours différents déterminent leurs différences d'approches de leur quartier, tout en mettant l'accent sur ce qu'elles ont de commun. En partenariat avec Marmite FM.
Trappy School
Quels sont les problèmes que connaissent une partie des agriculteurs, et notamment les éleveurs, qui expliquent les crises régulières et leurs mouvements so...
Aujourd'hui comme hier, ici ou ailleurs, le complotisme est puissant en période de crise, et se fonde sur un refus de l'information officielle qui va générer un récit alternatif à celui des pouvoirs en place. Au risque de raconter un peu n'importe quoi parfois, et de tomber dans la facilité de simplifier la réalité complexe en l'expliquant par l'action de boucs émissaires. Explications
Analyse du fonctionnement de la presse écrite à travers l'exemple des 4 grands quotidien nationaux. Quel est l'intérêt de la presse écrite par rapport aux autres médias ? Quel est son modèle économique ? Dans quelle mesure son indépendance est-elle garantie ?
À l'école
Depuis qu’elle a découvert le métier d'aide-soignante à 18 ans, Nadège est aide-soignante, et actuellement au service des Urgences de l'hôpital Foch de Suresnes. Portrait.
Après avoir découvert le rugby lors d’une intervention dans son école primaire, Sylvain Bouthier 43 ans, transmet aujourd’hui sa passion et son savoir en tant qu’entraineur des espoirs et responsable du centre de formation et au club du racing 92.
Dans le cadre d’ateliers d’éducation aux médias et à l’information, des élèves de 4ème du collège Alexandre Dumas de Maurepas sont devenus journalistes le temps d’un article. Aujourd’hui, portrait d’Olivier Haie, qui travaille depuis plus de 22 ans en tant que technicien de la lumière dans le cinéma, après s’être réorienté professionnellement.