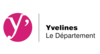Après le monde d’avant

Avec la sortie progressive du confinement, fusent les questions sur le monde d’après. Si on présente volontiers le virus comme une rupture, c’est sans doute d’abord un miroir grossissant des inégalités du monde d’avant. A observer la crise sanitaire depuis les quartiers populaires, la part sociale du virus saute aux yeux, exacerbant des problèmes qui étaient déjà là avant le corona. Je me limiterai ici à deux observations sur la mort et la pauvreté.
j’ai déserté complètement parce que j’ai perdu beaucoup de proches
La surmortalité statistique est univoque : partout, les plus démunis ont payé le plus lourd tribut à leur nation. Mais derrière ces chiffres, il y a des personnes. A mon modeste niveau, la difficulté pour communiquer avec Grâce, une jeune fille de 25 ans habitant l’Ile-Saint-Denis que je suis depuis plusieurs années avec le cinéaste Mathieu Vadepied dans le cadre d’un film documentaire en cours de tournage, a été une première piqûre de réel. Sans nouvelle depuis plusieurs semaines, la voilà qui se « justifie », confinement oblige, à distance et par texto interposés (« ça a pas été facile, j’ai déserté complètement parce que j’ai perdu beaucoup de proches, mais ça va beaucoup mieux, je n’étais pas en état, on s’appelle vite… »). Ces drames ne sont pas simplement des tragédies personnelles, ils révèlent les germes d’une profonde déconsidération politique. Voici, par exemple, ce qu’écrit Aïssata à son amie Nadia, deux enseignantes ayant grandi en Seine-Saint-Denis et aujourd’hui séparées par la vie, après l’avoir informée de la longue liste des proches endeuillés (deux amies ayant perdu un petit frère, deux pères et une mère) dans une correspondance qu’elles ont eu la délicatesse de partager avec moi.
« Je venais de faire des courses pour ma mère quand j’ai vu une famille africaine. Au début, je pensais qu’elle riait, le temps était radieux, et je me suis aperçue que les deux adolescentes qui accompagnaient la femme d’âge mûr étaient en train de pleurer. L’une d’elles d’ailleurs était par terre et l’autre se tenait à une voiture… Je suis allée à leur rencontre, je leur ai demandé si je pouvais les aider, inquiète, et là, la dame m’a dit que les filles venaient de perdre leur père… Je leur ai immédiatement présenté mes condoléances, puis je me suis approchée pour aider la maman à lever sa fille qui se trouvait par terre. Elle m’a remerciée, ensuite, elle m’a précisé qu’elle était leur mère… Très vite, je leur ai dit qu’elles ne pouvaient rester là, pleurer dans la rue, bien que la rue soit déserte… La mère m’avait dit sous le choc : “Je voulais aller faire mes courses à Carrefour Market…”, je lui ai alors ramassé son caddie, et dit : “Madame, il faut rentrer chez vous, vous pouvez pas rester là… Où habitez-vous ? Je vais vous accompagner…”. J’ai fait un bout de chemin avec elles. Après leur avoir dit au revoir, j’étais tellement triste, je ne pleurais pas ! Mais je sentais intérieurement que je changeais, le processus était en train de s’enclencher, quelque chose en moi a changé… Non seulement nous sommes le département le plus touché, mais nous sommes également mal traités : comment peut-on annoncer des nouvelles comme celle-ci aux gens dans la rue sans s’assurer que les familles soient chez elles… ? »
force est de constater que solidarité rime avec promiscuité : on se touche quand on se serre les coudes.
Le sentiment de dégoût qu’éprouve Aïssata tient de l’exaspération, non de la surprise. La crise sanitaire n’a fait qu’accélérer l’existant : omniprésence de la mort brutale comme possibilité et absence d’institutions pérennes pour en réparer les effets sociaux et psychologiques. Cette donnée fondamentale est souvent négligée quand il s’agit de comprendre la place prise par la religion, dans les quartiers populaires, dans la vie de nombreux jeunes (et si on parle beaucoup de l’Islam, il faudrait également mentionner l’importance prise par les églises évangélistes) et les réponses qu’elles offrent aux demandes de sens et de réconfort que le monde social ignore dans les grandes largeurs. Le non-accompagnement et le laisser-faire sont là structurellement historiques.
Comme l’illustre aussi le geste spontané d’Aïssata, la solidarité dans les quartiers populaires se fait de la main à la main, de proche en proche. Elle est nécessaire, dangereuse aussi, car elle brave les règles obligeantes de la distanciation sociale. En observant Amine, un garçon que nous suivons également dans le cadre de ce film, faire des maraudes quotidiennes avec son association Young Charity, force est de constater que solidarité rime avec promiscuité : on se touche quand on se serre les coudes. Young Charity, depuis le début du confinement, c’est 12 tonnes de fruits et légumes frais et 13 000 yaourts distribués. Dans les quartiers populaires, la fermeture des écoles signifie la fin des cantines, qui permettaient à beaucoup de parents de garantir un repas équilibré et régulier à leurs enfants. Prenons un autre exemple à Grigny, dans l’Essonne. Deux mois après le début de la crise sanitaire, l’épicerie sociale de la municipalité concerne 2 305 adultes et 2 633 enfants (soit environ 1/6e de la ville) et, chaque semaine, le nombre de colis alimentaires distribués ne fait que progresser : 39, 96, 142, 276, 610, 924, 976, 1 040… Le temps de la crise sociale sera lent et long.
On mesure sans doute aujourd’hui mieux l’importance des lieux tampons régis par la puissance publique qui ont disparu avec la crise sanitaire, y compris pour ceux qui ne se présentent pas comme tels mais jouent, de fait, une telle fonction. Je pense aux universités, dont la fermeture n’entraîne pour les étudiants précaires pas qu’un problème de « continuité pédagogique », mais aussi une perte de sécurité matérielle, sociale et affective.
la majorité des habitants des quartiers populaires appartient au bataillon des travailleurs essentiels
Cette faim et cette insécurité rampantes ont quelque chose d’obscène quand la majorité des habitants des quartiers populaires appartient au bataillon des travailleurs essentiels, ce « petit personnel » de service dont les « grandes actions » ont été applaudies tous les soirs à 20 heures : infirmiers, aides-soignants, ménagères, éboueurs, logisticiens, caristes, caissières, transporteurs routiers, etc. Amine était animateur sur le temps scolaire, il s’est reconverti en livreur.
Dans le monde d’avant, la solidarité de proximité et un filet public de sécurité minimal ont été des gestes barrières. Et si une juste redistribution des richesses faisait enfin le boulot dans le monde d’après ? Car si une grande partie de la population, d’ordinaire mobile et non entravée, a pu rester sereinement confinée, elle le doit aux déplacements et aux mouvements contraints et sous-payés d’une armée de l’ombre.
Dans le monde d’après, il faudrait pouvoir ralentir, dégrossir, privilégier la qualité et les circuits courts. Mais tout monde ne risque pas de se « libérer » de la même façon si une certaine déconsidération, bien ancrée dans le monde d’avant, survit à la pandémie.
Fabien Truong
Cet article a été initialement publié sur le site d’Alternatives Économiques : : https://www.alternatives-economiques.fr/fabien-truong/apres-monde-davant/00092962 , et reproduit sur le Trappy Blog avec l’accord de son auteur et d’Alternatives Économiques